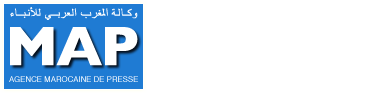
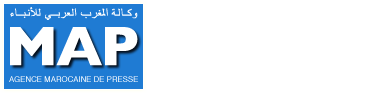

Cette causerie a été animée par le professeur Ibrahim Ahmad Maqari, Imam de la Mosquée nationale à Abuja et enseignant à l'Université Bayero-Kano au Nigeria, sous le thème "Les dimensions spirituelles et culturelles dans les relations maroco-nigérianes'', à la lumière du verset du Saint-Coran "Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des Nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux".
Le conférencier a, de prime abord, rappelé les relations humaines anciennes et profondes qui lient le Maroc et le Nigéria et dont la densité nécessiterait la mobilisation de toute une équipe pluridisciplinaire de chercheurs spécialisés pour en circonscrire l'étendue et la densité.
L'humanisme, une des caractéristiques majeures de l'Islam, y tient une place prépondérante autant au niveau des théories et des fondements que sur le plan pratique, a-t-il dit, notant qu'il n'est peut-être pas fortuit de rencontrer le terme "Homme" à deux reprises dans la Sourate "Al Alaq (L'Adhérence)", dont les cinq versets sont consacrés à l'être humain et à sa place dans l'univers.
Pour lui, l'humanisme ainsi perçu renvoie à l'ensemble des traits et caractéristiques propres à un individu ou à un groupe d'individus ou à une Nation, ayant en partage une conscience sociétale vertueuse animée par la recherche de la perfection dans les rapports avec les autres individus et les autres Nations.
Dans cette optique, les Nigérians ont trouvé dans l'Islam, cette nouvelle croyance qui leur est parvenue grâce aux Marocains, une religion qui s'accommode parfaitement de leurs ressorts profonds dans ce qu'ils ont de plus instinctif, du fait qu'elle ne comporte aucune ségrégation raciale ou ethnique, a-t-il poursuivi.
Il a relevé que ce principe humain suprême a, en effet, émaillé l'ensemble des relations maroco-nigérianes tant et si bien que la cité de Marrakech a ouvert ses portes à l'homme de lettres nigérian, Abi Ishaq Al Canimi, pour parfaire son érudition dans ses instituts, qui affluent d'oulémas et d'érudits, au moment où ses frères africains étaient emmenés dans des chaînes lors de la traite des esclaves sur les marchés occidentaux.
Parmi les caractéristiques humaines de ces rapports, il a évoqué la cohabitation pacifique malgré la différence des religions et croyances, rappelant que la notoriété des Marocains en tant qu'hommes de confiance était telle que nombre de Rois païens d'Afrique de l'Ouest leur ont confié des postes prestigieux dans la gestion de leurs royautés.
Selon lui, s'il est un terme qui, à lui-seul, résumerait la densité des rapports maroco-nigérians, ce serait bel et bien "la connaissance mutuelle" magnifiée dans le Saint-Coran, soutenant que ce vocable a ce mérite de reconnaître les particularités propres à chacun, sans velléités de dissoudre les identités culturelles des peuples.
Si les théoriciens se sont, certes, évertués à forger des définitions aussi diverses que variées du concept de la civilisation, il n’empêche que le socle sur lequel reposent toutes ces définitions n'est autre que la connaissance mutuelle, a-t-il estimé.
Aussi, a-t-il fait observer, que la reconnaissance de l'Autre, qui est en concomitance avec la notion de la connaissance mutuelle, revêt une charge beaucoup plus forte et plus pertinente que celle de "la tolérance", galvaudée à tout bout de champs par les temps qui courent.
Et de poursuivre que c'est précisément ce concept coranique de la civilisation qui enveloppe les relations maroco-nigérianes qui remontent à bien avant le Vème siècle avant Jésus-Christ, au temps du "commerce silencieux", selon l'acception d'Hérodote, à cette période lointaine où les transactions financières étaient bâties sur la confiance.
M. Maqari a soutenu que c'est grâce à ces vaillants marchands marocains que l'Islam s'est étendu, comme une traînée de poudre, dans de grandes régions de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigéria, notant que nombre de ces Marocains se sont établis parmi les populations indigènes où ils se sont mariés et fondé des familles.
L'Islam est entré au Nigéria avec un souffle soufi grâce à la dynastie Almoravide qui s'est appliquée à convertir rapidement le Soudan occidental au lieu de privilégier la démarche progressive, a-t-il signalé, ajoutant que, depuis cette date, nombre de Zaouias soufies y ont pris racine.
Certaines de ces confréries, originaires d'Orient comme la Qadiriya et la Rifaiya, ont fini par gagner l'Afrique de l'Ouest et le Nigéria, précisément à travers les comptoirs commerciaux marocains où elles ont pris une teinte locale, a-t-il rappelé.
Toutefois, a-t-il expliqué, la véritable révolution dans ces rapports spirituels a été entamée avec l'avènement de la Zaouia Tijaniya à Fès sous la houlette de son fondateur, Abi Al Abbbas Ahmed ben Mohamed Tijani, et dont l'édification allait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations maroco-nigérianes avec une densité et une profondeur inégalées.
Aujourd'hui, le Nigéria compte des dizaines de milliers de Zaouias Tijanes et chacune d'entre elles constitue, en fait, une sorte d'annexe culturelle du Royaume du Maroc dans ce pays, a-t-il poursuivi, soulignant au passage le dévouement indéfectible des adeptes de ces confréries, leur passion et leur attachement légendaires au Maroc.
La Tariqa Tijaniya a fleuri à Fès, capitale de la dynastie alaouite, comme un mouvement spirituel porté par la volonté d’étendre le drapeau de l'Islam en Afrique de l'Ouest où elle a donné ses fruits, a-t-il dit.
Vu sous ce prisme, l'Afrique et le Sahara ont trouvé dans cette dualité sunnite que représentent la dynastie alaouite et la Tariqa Tijaniya la meilleure alchimie ayant permis de propager la pensée islamique et les préceptes de la tradition prophétique, conférant ainsi au Maroc une aura sans égale qui a fait des Rois alaouites des pionniers de l'unité depuis la Méditerranée jusqu'au Niger, a-t-il soutenu.
Et peut-être est-il un de ces signaux qui ne trompent pas que les rencontres du cheikh nigérian avec son disciple Ahmed Al Yamani, venu de Fès au nord du Nigéria, coïncide avec la même année où commençait l'histoire de la dynastie chérifienne alaouite ?, s'est-il interrogé.
Rappelant la place de choix que l'Islam accorde à la connaissance et au savoir, le conférencier a relevé que les relations maroco-nigérianes ont, dans ce sens, transcendé la simple relation de transmission pour se muer en une acculturation complète dans le sens plein du terme; c'est-à-dire en une culture scientifique basée sur le triptyque de la culture, de la science et de la méthode.
Dans le domaine scientifique et culturel justement, il a signalé que la forte influence du Maroc sur le Nigéria se manifeste par la prépondérance du rite malékite qui s’est propagé en Afrique de l'Ouest et qui y tient une base solide comme une forteresse inexpugnable malgré les vaines tentatives de déstabilisation.
Pour preuve, il n'en veut que le fait que les manuels scolaires au Nigéria sont basés sur le rite malékite conformément aux dispositions de la Constitution du pays qui soulignent l'attachement aux fatwas du même rite dans les tribunaux légaux.
Ce rite, a-t-il poursuivi, tient sa force et son ancrage à sa richesse et aux efforts colossaux des érudits marocains qui en ont consacré les fondements en Afrique subsaharienne, d'une part, et aux oulémas et érudits nigérians qui veillent sur le rite malékite, autant en termes d'enseignement et d'apprentissage qu'en terme d'écriture et de sauvegarde.
Hormis de rares sources d'origine orientale parvenues au Nigéria à travers le Maroc, le chercheur se trouve devant une riche bibliographie de livres marocains ayant servi de cursus pour les étudiants au Nigéria, a-t-il indiqué.
Il a précisé que les cursus scolaires, élaborés par des oulémas marocains, sont adoptés par tous les instituts d'enseignement traditionnel depuis l'entrée à l'école coranique, jusqu'à l'apprentissage du Saint-Coran par la version de Warsh, en passant par la calligraphie marocaine connue par la beauté de ses traits et la finesse de l'agencement de ses lettres.
Parmi les personnalités nigérianes ayant fait leurs études au Maroc, il a cité Chiekh Mohamed Lamine Al Canimi, qui a déployé d'énormes efforts au service de la connaissance et du savoir. Désigné à la tête d'un Royaume d'Afrique de l'Ouest, il était connu pour son érudition, sa dévotion et son sens d'équité et de justice, ainsi que par ses voyages et ses joutes avec les dirigeants d'autres Royautés musulmanes proches et lointaines.
Entre autres érudits marocains ayant visité le Nigéria où ils avaient laissé des traces louables indélébiles, il a évoqué Makhlouf Ben Ali Salah Al Balbali (décédé en 940 de l'Hégire), Abderrahmane Ben Saqine (mort en 956), ou encore l'érudit Mohamed Ben Abderrahmane Lamghili (décédé en 909), qui fut le premier à avoir mis en place les systèmes de la jurisprudence, de la comptabilité et de l'administration du Royaume de Kano.
M. Maqari a souligné que ces relations spirituelles et culturelles et humaines ont une profondeur historique et une perspective humaniste que nul ne peut ni éluder ni dénier, et encore moins circonscrire par des barrières.
Si les Rois alaouites furent les gardiens de ces rapports denses à travers l'Histoire, les efforts louables que SM le Roi Mohammed VI ne cesse de déployer en faveur de l'unité africaine constituent en fait un prolongement du legs de Ses illustres aïeux et ces "Hautes initiatives royales scellent des retrouvailles frappées du sceau de la foi et de l'humanisme que les malintentionnés tentent vainement de rompre".
Sur la portée des initiatives marocaines dans ce cadre, il a cité le directeur de l'Observatoire français des études géostratégiques selon lequel l'engagement du Maroc en Afrique lui a valu d'être l'unique pays arabe à disposer d'une politique africaine claire et pérenne avec une connaissance précise et des relations humaines, culturelles et religieuses fructueuses avec les pays du continent.
Le conférencier a loué les efforts consentis par Amir Al Mouminine en faveur de la solidarité arabo-africaine, ainsi que les bonnes œuvres du Souverain au service de l'Islam et du bien-être des hommes, citant à cet effet la dernière visite de Sa Majesté le Roi au Nigéria qui a ouvert de larges perspectives de coopération.
Il a également évoqué le rôle de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains "en laquelle nous plaçons de grands espoirs pour une nouvelle aube qui puisse dissiper la pénombre qui a longtemps assombri notre discours religieux".
A l'issue de cette causerie, SM le Roi a été salué par Son Altesse Ibrahim Solo Ghambri, l'Emir de l'Emirat Lauren du gouvernorat de Qawra au Nigéria, Chawki Allam, le Mufti de la République d'Egypte, Hassan Haroun et Mohamed Ouahbi Saleh, Oulémas nigérians, Farouk Jolban Janahary, Imam de la Mosquée Moahmmed VI à Antsirabe et président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (section Madagascar), Adam Mohamed Kamal, membre du Conseil interconfessionnel en Ethiopie et président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (section Ethiopie), Aziza Yahya Mohamed Taoufik El Habri, ancienne professeur de droit à l'Université de Richmond (Etats-Unis), Mohamed Amine Touri, Imam, président du Conseil islamique supérieur et président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (section Gambie), Chouaib Abou Bakr, membre de l'Organisation des affaires islamiques et de la langue arabe, membre de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (section Ghana), Mohamed Sayed Al-Khair Abou Kacem, professeur universitaire à Khartoum, membre de l'Instance des Oulémas du Soudan, conseiller des affaires du Saint-Coran et président de la Fondation des Oulémas africains (section Soudan), Mohamed Salaheddine Al-Mestaoui, membre du Conseil islamique supérieur de Tunisie, Cheikh Abou Bakr Miga, fondateur de l'Association islamique Tidani au Burkina Faso, président d'honneur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (section Burkina).