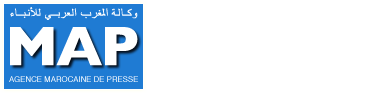
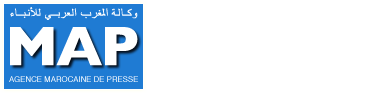

En Suisse comme ailleurs, l'ombre de la guerre russo-ukrainienne a plané sur le pays compte tenu de ses répercussions interconnectées dans divers domaines. La guerre étant porteuse d'un danger géopolitique imminent, d'une forte pression économique liée à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières et de défis sécuritaires incarnés notamment par l'afflux massif de réfugiés.
Alors que le pays sortait avec le moins de pertes de l'épreuve de la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine est venu remettre en cause les politiques publiques en matière de gestion des approvisionnements énergétiques nécessaires à l'alimentation de la machine industrielle. Les autorités à Berne, la capitale fédérale de la Suisse, misent sur l'implication volontaire des particuliers, des entreprises et des différentes institutions dans la mise en oeuvre des diverses mesures de rationalisation certes connues, mais "oubliées" en temps de la prospérité énergétique.
En prévision de l'arrivée de la saison hivernale, qui connaît un pic de la consommation d'énergie, les mesures adoptées pour rationaliser la consommation de l'énergie incluent la suppression des éclairages inutiles et la mise à l'arrêt des équipements énergivores chaque fois que cela est techniquement possible.
Le Conseil fédéral avait lancé une campagne sous le slogan "L'énergie est limitée. Ne la gaspillons pas", qui comprend des incitations à rationaliser l'électricité, baisser le chauffage, réduire la consommation d'eau chaude et à éteindre les appareils électriques et les lumières. Des mesures visant à renforcer l'approvisionnement énergétique et à soutenir l'objectif fixé par le Conseil fédéral de réduire la consommation de gaz de 15%.
Et parce que la sécurité énergétique est un enjeu vital pour tous les pays, en cas de situation de pénurie, le Conseil fédéral n'exclut pas la mise en place d'un schéma pour restreindre puis passer à un système de quotas pour le gaz aussi bien pour les particuliers que les institutions.
Sur le plan politique, l'épreuve de la guerre en Ukraine a suscité un débat sur la neutralité historique de la Suisse. La polémique a fait rage sur fond d'implication de la Suisse dans les sanctions économiques approuvées par l'Union européenne contre la Russie. La question n'est pas liée au choix entre l'abandon ou le maintien de cette neutralité, mais plutôt à l'interprétation des limites juridiques et politiques de la pratique diplomatique et des marges de la politique étrangère sous sa bannière.
La voie vers l'élargissement du concept de neutralité et la sortie à l'arène diplomatique a commencé avec l'adhésion de la Suisse à l'ONU, et a pris un saut qualitatif avec son élection, lors de la session de l'Assemblée générale à New York (septembre 2022), pour le première fois, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2023-2024. Une position qui confie au pays des responsabilités internationales qui le placeront au centre de polarisations potentielles concernant diverses crises, conflits et défis.
Face à l'élan des transformations et des menaces et à la nécessité de prendre des positions claires et décisives dans un contexte mondial tumultueux, nombre de voix se sont prononcées en faveur de la nécessité de frapper cette neutralité du sceau de la flexibilité et prendre des distances par rapport à une application littérale de ce concept qui empêche l'État d'interagir avec les événements et les transformations et de se positionner d'une manière conforme à ses convictions et à ses intérêts aussi. Toutefois, d'autres voix adhèrent à cette interprétation littérale d'un système qui a assuré à la Suisse sa sécurité et sa position distinguée loin des conflits.
Socialement, le débat sur la retraite a été fortement présent dans les référendums organisés dans le cadre du système de démocratie directe adopté par la Suisse et 50,6 % des électeurs ont soutenu le relèvement de l'âge de départ à la retraite des femmes à 65 ans.
Par ailleurs, et après deux tentatives infructueuses en 2004 et 2017, les autorités ont pu recueillir suffisamment de votes pour imposer la "stabilité" du système de l'assurance vieillesse, qui subit une forte pression, alors que l'espérance de vie augmente et que la génération des baby-boomers commence à atteindre l'âge de la retraite.
La partie la plus controversée du projet de réforme stipule que les femmes travaillent aussi bien que les hommes jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, avant de pouvoir percevoir une retraite à taux plein, alors que celles-ci partaient à retraite à soixante-quatre ans auparavant.
En effet, le parlement avait approuvé l'an dernier les principales mesures de la réforme de ce système de retraites, qui comprend également une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, les partis et les syndicats de gauche ont dénoncé une réforme, qui, selon eux, "se fait au détriment des femmes".
Sur le plan sportif, l'année 2022 a constitué une véritable consécration de la montée en force du football suisse, dans la mesure où l'équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe du monde Qatar-2022, dans un groupe qui a connu la disqualification d'un pays purement footballistique comme l'Italie.
Pour la Ligue des nations de l'UEFA, la Suisse a obtenu des résultats impressionnants contre des puissances de la taille de l'Espagne. Cependant, l'événement sportif le plus marquant qui a fait le tour du monde reste l'annonce du départ à la retraite du célèbre joueur de tennis, Roger Federer.